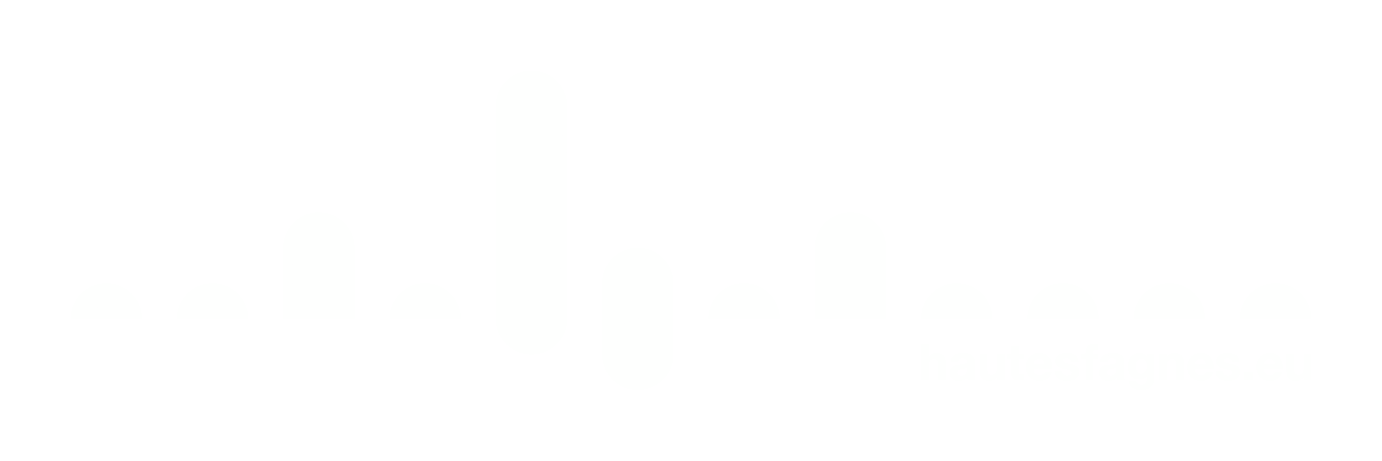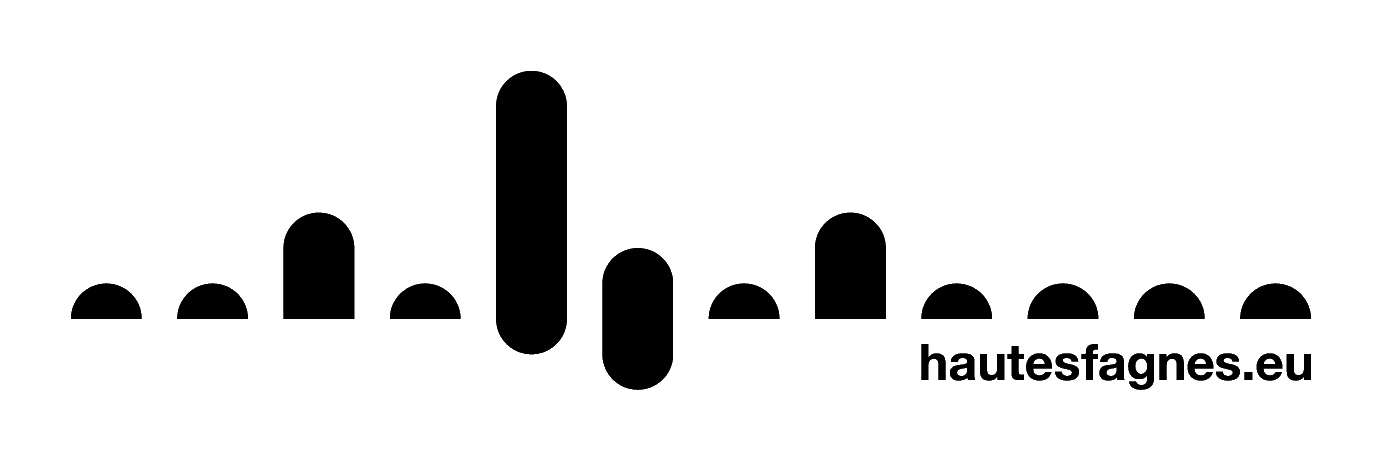Le climat et le paysage
Environ 200 jours de précipitations (pluie, neige, brouillard), 150 jours de brouillard par an… Les statistiques du climat fagnard sont riches en extrêmes, avec en moyenne 98 jours accompagnés de gelées et environ 40 jours de couverture neigeuse par an. L’hiver se prend parfois des allures sibériennes : il n’est pas exceptionnel de voir la température nocturne chuter à 20°C sous zéro ! Les premières gelées sévissent souvent avant même la fin octobre, les dernières s’accrochent jusqu’à la fin mai.
Le mois de novembre voit statistiquement tomber les premiers flocons. Une température annuelle moyenne d’à peine 7,5°C, trois mois par an seulement (juin, juillet et août) à l’abri du gel…
Un milieu insolite sous nos latitudes

Les Hautes-Fagnes présentent des paysages de landes et de tourbières habituellement rencontrés dans des contrées plus nordiques ou de plus haute altitude. Leur climat froid, particulièrement humide, et la composition de leurs sols, assurent la persistance d'une flore et d'une faune inhabituelles pour nos régions.
Deux phénomènes naturels expliquent notamment l'existence de cet écosystème en Belgique. Le haut plateau fagnard est le premier obstacle rencontré par les nuages amenés par les vents atlantiques dominants. Il en résulte une abondance exceptionnelle des précipitations (plus de 1.400 mm de pluie par an). D'autre part, son sous-sol est constitué de roches et d'argiles peu perméables qui empêchent l'infiltration de l'eau. Ces conditions favorisent particulièrement le développement de milieux humides comme les marais et les tourbières.
Un paysage transformé par l'homme

Il y a 2.000 ans, une forêt composée essentiellement de feuillus (hêtres, aulnes, bouleaux, chênes, etc.) recouvre encore la majeure partie du haut plateau. Celle-ci ne cède la place, ici et là, qu'à quelques étendues de tourbières.
Dès le Moyen Age, l'exploitation humaine débute et bouleverse complètement le paysage : coupes de bois, pâturages, cultures et extractions de la tourbe engendrent peu à peu un milieu de vastes landes. Au 19ème siècle, l'introduction de l'épicéa apporte un nouveau bouleversement du paysage et du sol. Au 20ème siècle, le tourisme introduit une autre forme d'exploitation du haut plateau.
Ruisseaux, rivières, barrages
L’eau tombée du ciel, tout comme celle qui ressurgit du sol tourbeux, s’écoulent des fagnes par de nombreux petits ruisseaux qui, en se joignant les uns aux autres, finissent par créer de véritables rivières. Suivant différentes orientations, la Helle, la Soor, la Roer, le Bayehon, le Trôs Marets, la Holzwarche, la Warche, l’Eau Rouge, le Polleur, la Hoëgne, la Gileppe, le Getzbach, la Vesdre, l’Eschbach, le Steinbach et leurs innombrables petits affluents se frayent ainsi un chemin à travers les fagnes, puis les forêts en direction des vallées, alternant souvent des tronçons un peu plus paisibles avec des passages torrentueux. Les profondes vallées sauvages des alentours des Hautes Fagnes sont souvent d’une beauté inégalée…
Pour collecter les eaux des fagnes, les hommes ont dressé cinq grands barrages, dont quatre en territoire belge. Le plus ancien et le mieux connu est bien sûr celui de la Gileppe, entamé en 1867 et terminé en 1875. Le colossal lion en pierre, qui domine le barrage de ses 13,5 m de hauteur et ses 130 tonnes, rend l’ouvrage plus impressionnant encore ! Les eaux de la Gileppe devaient initialement servir à l’industrie du textile, florissante à l’époque dans la région de Verviers et dont les besoins se chiffraient à 40 millions de litres par jour ! D’autres barrages ont été dressés en travers de la Vesdre (à Eupen) et de la Warche (à Butgenbach et Robertville). De nos jours, ces ouvrages fournissent l’eau potable à plus d’un million d’habitants, sans oublier de l’électricité verte, certes en quantités assez modestes.
La flore
Des espèces végétales rares colonisent les tourbières et les zones humides, telles que la narthécie des marais, la linaigrette, la bruyère quaternée, l’andromède, la trientale d’Europe et la canneberge, etc...
Les tourbières
Les tourbières sont des écosystèmes où se forme la tourbe, c'est-à-dire de la matière organique partiellement décomposée. Pour qu'une tourbière puisse se développer, il faut que l'ensemble des apports en eau (ruissellement, pluies, neige, nappe souterraine) excède en permanence les pertes en eau (écoulements, évaporation, transpiration des plantes).
Une exigence supplémentaire est que l'écoulement de l'eau soit faible, voire inexistant (eaux stagnantes)
Une gigantesque éponge
Dans beaucoup d’endroits humides des Hautes-Fagnes, vous pouvez voir des sphaignes, sous forme de petits coussins isolés dans des dépressions du sol ou d’immenses tapis à la surface des tourbières. Les sphaignes sont de petites plantes primitives, qui se reproduisent à l’aide de spores et qui affectionnent les milieux humides et pauvres en nutriments. Pendant que la partie supérieure de la plante pousse, la partie inférieure dépérit : c’est ainsi que s’accumule, à la base des plantes d’une tourbière, une couche de matière organique morte et partiellement décomposée que l’on appelle la tourbe.
Plantes typiques des fagnes
Parmi les plantes les plus typiques des Hautes Fagnes, on peut citer les linaigrettes (linaigrette à feuilles étroites, linaigrette vaginée) : à la fin du printemps, ces plantes développent de petits plumets blancs soyeux qui donnent aux paysages un aspect chatoyant. Dès le début juillet, la narthécie des marais entoure les tourbières d’un tapis jaune éclatant. Les feuilles de la droséra à feuilles rondes sont garnies de petits tentacules terminés par des gouttes d’un liquide gluant qui ressemblent à de petites gouttes de rosée. Malheur à l’insecte qui se laisse prendre au piège : il se verra digéré par les enzymes secrétés par cette plante très particulière. Les protéines ainsi fournies par ses victimes représentent une source de nourriture vitale pour la plante dans le milieu particulièrement pauvre des tourbières.
Trois espèces de myrtilles se partagent les landes plus sèches et les forêts : la myrtille commune, la myrtille de loup et l’airelle rouge. Parmi les autres plantes emblématiques des fagnes, mentionnons la canneberge, l’andromède, la camarine noire, la gentiane des marais, la trientale d’Europe…
La faune
Le coq de bruyère, une espèce protégée…
Les Hautes Fagnes hébergent une multitude d’espèces de plantes et d’animaux. Une des espèces les plus vulnérables est le tétras lyre, dont la toute dernière population dans notre pays s’accroche à la vie sur le plateau fagnard. Au printemps, les coqs, arborant leur éclatante livrée nuptiale, se rassemblent sur leurs arènes au milieu des fagnes. Le bal peut commencer, durant lequel les mâles vont s’affronter dans le but de s’attirer les faveurs des femelles. Hélas, cette espèce emblématique est extrêmement menacée.
Réinsertion
Une équipe de l'Université de Liège, en collaboration avec des spécialistes allemands et néerlandais, souhaite augmenter la population du coq de bruyère dans les Hautes Fagnes. À cette fin, en 2017, 10 exemplaires ont été importés de Suède et relâchés en fagne et 18 de plus au printemps 2018. Les responsables sont optimistes quant à la réinsertion du coq de bruyère dans les Hautes Fagnes.
Oiseaux dans les Hautes Fagnes
Parmi les oiseaux remarquables nichant dans les Hautes Fagnes, citons la chouette de Tengmalm, la chevêchette naine, l’autour des palombes, le milan royal, le pic mar, la locustelle tachetée, le pipit farlouse, le grand corbeau, la cigogne noire… Pendant les migrations de printemps et d’automne, les fagnes accueillent également de beaux groupes de grues cendrées, oiseaux particulièrement élégants qui passent souvent la nuit dans les étendues de tourbières. Les visiteurs d’hiver sont entre autres le busard Saint-Martin, la pie-grièche grise, le bec-croisé des sapins, le bouvreuil pivoine et le sizerin flammé.
Les grands mammifères herbivores, le cerf noble, le chevreuil et le sanglier, sont pour ainsi dire omniprésents, bien que la densité de leurs effectifs demeure moyenne. Le renard, le blaireau et le chat forestier hantent les étendues de forêts sauvages…
Papillons des fagnes
Les Hautes Fagnes et les vallées des cours d’eau descendant du plateau abritent de nombreuses espèces de papillons diurnes, parmi lesquels le Cuivré de la bistorte, le Cuivré écarlate, le Nacré de la bistorte, le Nacré de la sanguisorbe, le Nacré de la canneberge et le Petit collier argenté sont de rares bijoux, qui dépendent entièrement de biotopes et de plantes nourricières très particuliers. 37 espèces de libellules chassent au-dessus des fagnes, dont Aeschna subarctica, une espèce particulièrement rare.